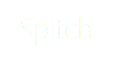Pourquoi l’éloquence n’est pas forcément synonyme de compétence
Depuis plus de 50 ans les médias de masse ont véhiculé cette idée que pour intéresser le public il était indispensable que ça aille vite, il fallait savoir être succinct, « catchy », to-the-point. A l’image des séries américaines, que ce soit pour la fiction, les débats ou le divertissement, tout devait pouvoir s’enchainer avec rapidité, naturel et sans aucune hésitation.
Ce formatage médiatique a eu pour principale conséquence de nous habituer à ce flow, à cette spontanéité mise en scène, qui a forcé notre admiration envers ceux qui se montraient capables d’éloquence.
A tel point qu’on se surprend aujourd’hui à évaluer la compétence, le sérieux et la fiabilité de nos interlocuteurs par leur capacité à démontrer un raisonnement fluide à l’oral. Leurs possibles hésitations étant souvent interprétées comme un signe de faiblesse, d’ignorance ou de mensonge. Une réalité qu’il est urgent de démystifier.
L’art vs la vraie vie
Depuis presque 10 ans, notre rôle à l’agence Spitch est de coacher des dirigeants à la rhétorique, au storytelling et à la prise de parole. On est donc bien placés pour comprendre l’importance de la maitrise de ces compétences dans la capacité de chacun à intéresser et convaincre un public à l’oral. Au quotidien nous travaillons le discours de nos clients, et formons les orateurs de façon à ce qu’ils parviennent à présenter leurs idées, produits ou services, avec charisme et éloquence.
Mais le souci avec l’éloquence, avec cet art de bien parler, cette aptitude à s’exprimer avec aisance, cette capacité d’émouvoir et de persuader à l’oral, c’est qu’en observant cette performance on peut parfois finir par penser qu’il s’agit là d’un état naturel, spontané, d’un individu supérieur touché par la grâce, qui s’exprime toujours ainsi, sans effort, au quotidien.
Et c’est bien évidemment une erreur. L’art oratoire comme tous les autres arts demandent des années d’entrainement, des années de travail acharné pour arriver à produire une performance dont le public ne sera plus capable d’en visualiser les ficelles.
Et c’est sûrement là le principal biais cognitif que l’on peut attribuer à l’art en général. Par la réalisation d’une prouesse artistique, un orateur, comédien, chanteur, danseur, musicien, ou sportif, tous démontrent le niveau le plus élevé de maitrise de leur art, avec une légèreté, une spontanéité, une fluidité, comme si cela leur était inné, alors qu’en réalité il leur aura fallu des années d’entrainement pour parvenir à représenter de la sorte, pendant un court laps de temps passé sur scène.
Et c’est un biais cognitif car chacun de nous est capable de s’exprimer à l’oral, jouer la comédie, chanter ou danser. A un niveau médiocre, pour la plupart d’entre nous, mais ce simplement parce qu’on a pu être déterminé par notre milieu social, ou que notre histoire de vie a fait que l’on a consacré du temps à des activités plutôt qu’à d’autres. Et que celles-ci qui demandent d’y consacrer une vie pour parvenir à les maitriser, comme seule une poignée de personnes en 2000 ans de civilisation y sont parvenues, n’ont pas particulièrement croisé notre destin, comme il l’aurait fallu.
Mais pourtant, en regardant des artistes représenter leur art sur scène, il nous vient à chacun cette pensée, que c’est ainsi que l’on joue la comédie, que l’on fait rire, que l’on chante, que l’on danse, et que nous, communs des mortels nous ne sommes que des êtres inférieurs incapables de jouer cette comédie, de faire rire, de chanter ou de danser comme il se doit.
Éloquence vs Rhétorique
Ce biais cognitif de l’art, est d’autant plus problématique lorsque l’on évoque l’art oratoire. Car s’il faut beaucoup d’années de travail pour devenir un grand orateur, à la différence des autres arts, la vérité du message, de l’opinion que l’on transmet à l’oral, a une importance toute particulière.
On ne demande pas à un comédien que le scénario qu’il joue soit issu d’une histoire vraie, ni à un musicien que la tristesse que peut transmettre sa symphonie soit issue de son vécu. Quant au sportif, il n’y a pas de message dans sa performance, autre peut-être que le dépassement de soi que permet l’effort continu. On demande juste que cela semble vrai, on ne cherche qu’à s’émouvoir au travers de leur art.
A l’inverse, lorsque quelqu’un s’exprime avec éloquence, exprime une opinion à l’oral, défend une idée, explique un raisonnement ou répond à une question qu’on lui pose, les normes sociales exigent que le contenu de notre message soit le plus authentique possible, que l’on croit en ce que l’on dit, sinon c’est un mensonge, une fraude à l’éthique.
Ainsi, lorsque l’on observe un grand orateur sur scène, notre cerveau a pris l’habitude d’associer l’éloquence de l’orateur à sa légitimité et sa maîtrise des sujets qu’il défend à l’oral.
La politique joue sur cette ambiguïté même, on vote pour celui qui nous paraît le plus compétent, avec souvent pour seul facteur influençant notre jugement, que sa capacité à sembler maîtriser les sujets lors de ses discours, ou sa capacité à répondre instinctivement lors ses débats.
Et cette ambiguïté on la retrouve dans toutes les interactions sociales, lorsque l’on parle à un vendeur, lorsque l’on écoute un collègue présenter un projet, on évalue un candidat pour un recrutement, ou l’on cherche à estimer la vérité dans les justifications de notre conjointe. L’éloquence, la capacité à s’exprimer avec aisance et affirmation, pèse sur notre jugement.
On est plus facilement enclins à faire confiance à ce vendeur qui semblait honnête, valider le projet qui nous a été bien présenté, recruter le candidat qui paraissait sérieux ou de croire notre conjointe lorsqu’elle nous explique sans hésitation qu’hier soir elle n’a pas répondu à notre appel parce qu’elle dormait avec sa grand-mère.
On se dit dans le fond, que si c’est dit avec une certaine éloquence c’est que cela doit contenir une part de vérité.
Alors qu’en réalité rien n’est plus dissociable que la vérité, de l’éloquence de l’orateur qui la soutient.
Et la meilleure preuve de cela c’est l’éloquence du sophiste. Le sophiste c’est celui qui n’ayant en vue que la persuasion d’un auditoire, développe des raisonnements dont le but est uniquement l’efficacité persuasive, et non la vérité, et qui à ce titre contiennent souvent des vices logiques, bien qu’ils puissent paraître à première vue cohérents.
A l’inverse, le rhéteur est celui qui a recours à la rhétorique au sens d’Aristote et qui construit un discours cohérent et persuasif dans le but de convaincre de l’intérêt des idées qu’il défend, celles dont il est intimement persuadé lui-même. Et pour cela il peut avoir recours à des syllogismes pour démontrer le bien-fondé de son raisonnement, des statistiques pour soutenir ses analyses et même un contenu émotionnel (histoires, émerveillement, humour) pour transmettre une vérité que la rationalité n’est parfois pas capable d’exprimer pleinement.
Il n’y a donc pas de mal à essayer de persuader quelqu’un, la rhétorique est le propre de l’homme, c’est l’art de convaincre de l’intérêt de ses idées. Ce qu’il faut décrypter ce n’est pas l’effort mis pour convaincre un auditoire, mais les intentions de l’orateur, si elles sont sincères, quelle idéologie est défendue et vérifier les faits et possibles conséquences.
Éloge du doute
La semaine dernière, alors que j’assistais à une conférence, l’orateur s’est vu surprendre par une question à laquelle il ne s’attendait sûrement pas, et pour y répondre, il s’est exprimé avec une certaine hésitation, des bafouillements, et a même fini par revenir sur ses propos afin de clarifier sa position.
En sortant de la salle, certaines personnes exprimaient des critiques envers l’orateur, qui au vu de ses hésitations, leur avait semblé ne pas maitriser pleinement son sujet.
Si je partage cet épisode avec vous c’est parce que cela est parfaitement représentatif du caractère survalorisé de l’éloquence de nos jours. Nous sommes tellement habitués à associer l’éloquence à la compétence, que ce soit par la mise en scène des éditorialistes sur BFM, le discours « cutté » des youtubeurs ou encore celui plein de certitudes des influenceurs en tous genres, que le simple fait de douter ou de prendre le temps de la réflexion avant de s’exprimer, nous est directement interprété comme un manque d’assurance, de crédibilité, désormais intolérable à nos yeux.
La culture populaire est-elle même remplie de signes nous invitant à faire ce type de jugement réducteur : « Si c’est flou c’est qu’il y a un loup », « répondre du tac au tac », le savoir sur « le bout de la langue », tout autant d’adages populaires qui flattent l’égo de la spontanéité supposée du savoir.
Alors qu’en réalité c’est tout l’inverse, le doute est à l’origine même de l’intelligence humaine. Il n’y a de savoir que parce qu’il existe un doute originel. Que parce que l’on a eu la capacité de remettre en cause le statuquo. Ce n’est qu’en faisant émerger un problème, ce n’est par ce que l’on doute de nos certitudes, que l’on peut construire par la suite des certitudes plus authentiques, ou des vérités plus fondées.
Ce n’est donc que par le fait que notre quiétude d’un savoir simpliste soit troublée, que l’on peut améliorer son niveau de connaissances pour parvenir à un nouveau niveau de réflexion, supérieur.
Et puis il faut des années d’études pour former une opinion sérieuse, une vie pleine d’expériences pour prodiguer des conseils remplis de sagesse, une remise en cause continue pour devenir un intellectuel dont les travaux sont dignes de confiance.
Avoir une réponse instantanée à toutes les questions, comme si l’on maitrisait tous les sujets, est en réalité davantage dénonciateur du sophisme du séducteur, du mensonge du manipulateur ou de l’endoctrinement du manipulé.
Ainsi, et pour conclure, avant de juger à la hâte des compétences d’un interlocuteur ou d’un orateur, de par ses hésitations à l’oral, valorisons dans chaque hésitation l’effort de remise en cause et la tentative d’adresser la meilleure réponse possible à son auditoire et ce quitte à prendre le risque de ne pas atteindre les canons de l’éloquence que la société souhaite nous imposer. Un effort de plus en plus rare, dans une société ou l’instant prend le pas sur la réflexion.